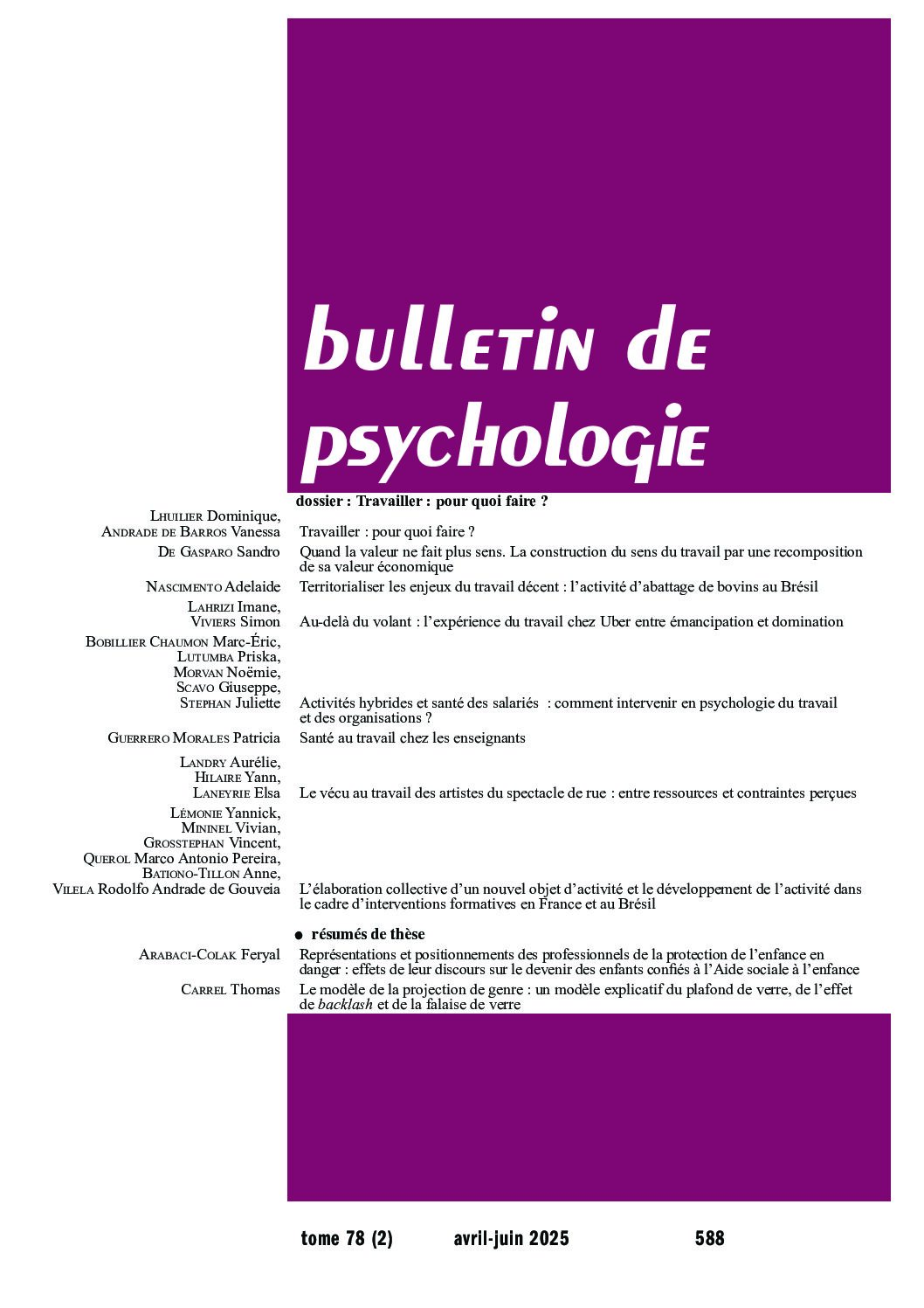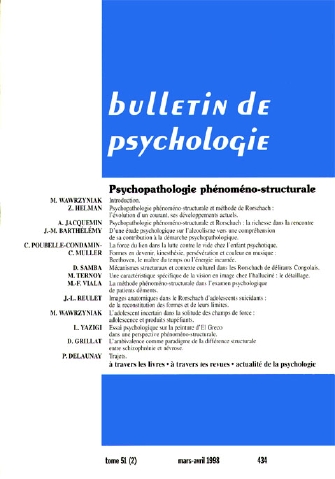Description
Numéro consultable en ligne sur Cairn
• Travailler : pour quoi faire ?
Lhuilier (Dominique), Andrade de Barros (Vanessa).— Travailler : pour quoi faire ?, Bulletin de psychologie, Tome 78 (2), N°588, 2025, p. 3-7.
Title: Working: What for?
De Gasparo (Sandro).— Quand la valeur ne fait plus sens. La construction du sens du travail par une recomposition de sa valeur économique, Bulletin de psychologie, Tome 78 (2), N°588, 2025, p. 9-22.
Résumé : L’objectif de cet article est d’explorer les relations entre le sens, comme rapport subjectif au travail médiatisé par la dynamique de la reconnaissance, et la valeur économique, comme finalité productive déterminée par un certain modèle économique. La souffrance au travail peut être interprétée comme l’incapacité du modèle économique de l’organisation à comprendre, reconnaître et soutenir la dynamique productive réelle à l’oeuvre dans le travail du sujet en activité. Une observation clinique issue d’une intervention-recherche dans une PME est analysée en articulant les apports des sciences économiques et des sciences cliniques du travail. La discussion examine la perspective servicielle comme nouvel horizon du travail, permettant de relier la quête de sens du sujet et un modèle de développement renouvelé et plus soutenable.
Title: When value no longer makes sense: The construction of the meaning of work through a recomposition of its economic value
Abstract: This article aims to explore the relationships between meaning, as a subjective relation to work mediated by the dynamics of recognition, and economic value, as a productive purpose determined by a certain economic model. Suffering at work can be interpreted as the inability of the organization’s economic model to understand, recognize, and support the real productive dynamic in the work of the subject in activity. A clinical observation resulting from an intervention-research in an SME is analyzed by bringing together the contributions of economics and the clinical science of work. The discussion examines the service-based perspective as a new horizon of work, making it possible to link the quest for meaning of the subject with a renewed and more sustainable model of development.
Nascimento (Adelaide).— Territorialiser les enjeux du travail décent : l’activité d’abattage de bovins au Brésil, Bulletin de psychologie, Tome 78 (2), N°588, 2025, p. 23-35.
Résumé : Cet article a pour objectif principal d’enrichir la réflexion sur le potentiel de l’échelle territoriale pour analyser l’activité et les enjeux du travail décent, en prenant comme exemple un contexte productif brésilien aux prises avec des contradictions entre nourrir les humains et détruire la nature. Les résultats nous éclairent sur la prise en compte du territoire, par les travailleurs, dans les façons de travailler et comment cet ancrage territorial peut permettre de comprendre les enjeux de santé au travail. Cette expérience corrobore la nécessité d’enrichir les approches classiques de l’ergonomie, en intégrant des approches systémiques, multiscalaires et socio-historico-culturelles aux analyses.
Title: Territorializing the issues of decent work: Cattle slaughtering in Brazil
Abstract: The main aim of this article is to enrich thinking on the potential of the territorial scale for analyzing decent work, taking the example of a Brazilian productive context grappling with the contradictions between feeding humans and destroying nature. The results shed light on how workers take the territory into account in the way they work, and how this territorial anchoring can help us understand occupational health issues. This experience corroborates the need to enrich classic ergonomic approaches by integrating systemic, multi-scalar, and socio-historical-cultural approaches into analyses.
Lahrizi (Imane), Viviers (Simon).— Au-delà du volant : l’expérience du travail chez Uber entre émancipation et domination, Bulletin de psychologie, Tome 78 (2), N°588, 2025, p. 37-49.
Résumé : Entre les promesses des plateformes pour répondre à la crise de sens du travail et la réalité de ceux qui y oeuvrent, cette étude qualitative réalisée au Québec, auprès de 48 chauffeurs et livreurs Uber, cherche à comprendre pour quoi les travailleurs Uber s’y investissent et en quoi leur expérience du travail est un vecteur d’émancipation ou de domination. L’analyse des entretiens individuels repose sur un cadre mobilisant des apports théoriques d’Alexis Cukier, de la psychodynamique du travail et de la sociologie clinique. Les trois profils d’engagement repérés chez les travailleurs interrogés sont axés sur : 1° la subsistance, 2° l’opportunité entrepreneuriale et 3° des objectifs hédoniques. Mis en perspective avec leur conscience relative de la subordination induite par les modalités contractuelles qui les lie à Uber, ces profils révèlent des formes diverses d’expérience du travail, oscillant entre émancipation et domination.
Title: Beyond the wheel: Work experiences at Uber, between emancipation and domination
Abstract: Between the promises of platforms to address the crisis of the meaning of work and the reality faced by those who find work on these platforms, this qualitative study conducted in Quebec with 48 Uber drivers and delivery workers seeks to understand why they work for Uber and whether their work experience acts as a vector of emancipation or domination. The analysis of individual interviews is based on a framework incorporating theoretical contributions from Alexis Cukier, the psychodynamics of work, and clinical sociology. The three engagement profiles identified among the interviewed workers are focused on: 1) subsistence, 2) entrepreneurial opportunity, and 3) hedonic goals. When viewed in the light of their relative awareness of the subordination induced by the contractual terms binding them to Uber, these profiles reveal diverse forms of work experience, oscillating between emancipation and domination.
Bobillier Chaumon (Marc-Éric), Lutumba (Priska), Morvan (Noëmie), Scavo (Giuseppe), Stephan (Juliette).— Activités hybrides et santé des salariés : comment intervenir en psychologie du travail et des organisations ?, Bulletin de psychologie, Tome 78 (2), N°588, 2025, p. 51-63.
Résumé : Les récentes évolutions du monde du travail, marquées par l’émergence de nouvelles pratiques telles que le travail nomade, mobile, comodal, àdistance et le Flex-office, se sont généralisées dans tous les domaines professionnels, entraînant une hybridation des méthodes de travail. Ce modèle hybride implique une alternance ou une coexistence de différents modes d’organisation, d’espace et de temps, que les individus doivent réapprendre à gérer, ajuster et combiner. Dans ces nouveaux contextes professionnels, les pratiques deviennent plus personnalisées et moins visibles, plus dispersées et fragmentées, tout en étant également plus transparentes et éphémères. Cela pose de nouveaux défis d’analyse pour les disciplines qui oeuvrent dans la compréhension et la restitution du travail réel. Cet article vise à décrire ces nouvelles formes de travail et à explorer des méthodes d’analyse et d’intervention permettant de rendre ces activités plus explicites et visibles, afin de stimuler des réflexions collectives sur la façon de repenser ces configurations innovantes du travail.
Title: Hybrid activities and employee health: What can industrial and organizational psychology do?
Abstract: Recent developments in the world of work, marked by the emergence of new practices such as nomadic, mobile, co-modal, remote, and flexoffice working, have become widespread in all professional fields, leading to a hybridization of working methods. This hybrid model involves the alternation and/or coexistence of different modes of organization, space, and time, which individuals must relearn to manage, adjust, and combine. In these new professional contexts, practices become more personalized and less visible, more dispersed and fragmented, while also being more transparent and ephemeral. This poses new analytical challenges for the disciplines involved in understanding and reconstructing real work. The aim of this article is to describe these new forms of work and to explore methods of analysis and intervention that can make these activities more explicit and visible, in order to stimulate collective reflection on how to rethink these innovative configurations of work.
Guerrero Morales (Patricia).— Santé au travail chez les enseignants, Bulletin de psychologie, Tome 78 (2), N°588, 2025, p. 65-75.
Résumé : Cet article décrit et analyse une année d’intervention dans un projet pilote au lycée de filles de Santiago-Centre. Inspirés par des travaux contemporains, nous avons collaboré avec des équipes « opératives » pour améliorer la qualité de vie et modifier les méthodes de travail. L’objectif est d’analyser les activités proposées pour réfléchir sur le travail, en intégrant les définitions de santé mentale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les propositions ergonomiques françaises. Nous avons aussi souligné la distinction entre travail et emploi, et entre travail prescrit et réel. Enfin, nous répondons aux recommandations de l’Organisation internationale du travail et de l’OMS post-pandémie pour prévenir les risques psychosociaux.
Title: Health at work for teachers
Abstract: This article describes and analyzes a year-long intervention in a pilot project at the girls’ High School in Santiago Centro. Inspired by contemporary works, we collaborated with “operative” teams to improve quality of life and modify work methods. The objective is to analyze the proposed activities to reflect on work, incorporating the World Health Organization’s definitions of mental health and French ergonomic proposals. We also emphasized the distinction between work and employment, and between prescribed and real work. Finally, we adhered to the post-pandemic recommendations of the International Labour Organization and the World Health Organization to prevent psychosocial risks.
Landry (Aurélie), Hilaire (Yann), Laneyrie (Elsa).— Le vécu au travail des artistes du spectacle de rue : entre ressources et contraintes perçues, Bulletin de psychologie, Tome 78 (2), N°588, 2025, p. 77-90.
Résumé : Alors que les métiers du spectacle de rue font partie des plus anciens, la prise en compte de la santé des professionnels de ce secteur a longtemps été sous-estimée. L’objet de cette recherche est d’explorer les composantes du vécu au travail des artistes du spectacle de rue au travers d’un entretien collectif de huit personnes. L’analyse thématique réalisée cherche à comprendre leurs perceptions des ressources et contraintes de leur travail. Les résultats montrent que le métier d’artiste de spectacle de rue, par sa grande autonomie organisationnelle, les apprentissages permanents, la perception directe d’être utile à autrui et d’appartenir à un métier à part, contribue au sens de l’activité de travail des artistes. À ces résultats, il faut ajouter que ces derniers gèrent les contraintes du métier principalement à l’aide de stratégies individuelles telles que le soutien familial. Cette étude suggère d’explorer les pistes organisationnelles pour soutenir le métier d’artistes.
Title: The work experiences of street performers: Perceived resources and constraints
Abstract: Although the street performance profession is one of the oldest, the health of professionals in this sector has long been ignored. The aim of this research is to explore the components of the work experience of street performers through a group interview with eight people. The thematic analysis carried out seeks to understand their perceptions of the resources and constraints of their work. The results show that the profession of street performer, with its great organizational autonomy, constant learning, direct perception of being useful to others, and belonging to a special profession, contributes to the meaning of the performers’ activity. In addition to these results, performers manage the constraints of their profession mainly through individual strategies such as family support. This study suggests investigating organizational avenues to support the performers’ profession.
Lémonie (Yannick), Mininel (Vivian), Grosstephan (Vincent), Querol (Marco Antonio Pereira), Bationo-Tillon (Anne), Vilela (Rodolfo Andrade de Gouveia).— L’élaboration collective d’un nouvel objet d’activité et le développement de l’activité dans le cadre d’interventions formatives en France et au Brésil, Bulletin de psychologie, Tome 78 (2), N°588, 2025, p. 91-104.
Résumé : Cet article présente deux interventions formatives mobilisant la méthodologie du laboratoire du changement en France et au Brésil, respectivement dans un institut universitaire de formation des enseignants et dans un hôpital. S’appuyant sur la théorie historico-culturelle de l’activité et la théorie de l’apprentissage expansif, les interventions visent à permettre aux participants de retrouver un nouveau sens en reconceptualisant l’objet de leur activité. Dans ce processus de reconceptualisation, l’identification des contradictions, historiquement héritées au sein des systèmes d’activité, joue un rôle de premier plan. Les deux interventions permettent d’envisager le processus comme une réorientation de la trajectoire historique de l’objet de l’activité nécessitant une mise en articulation des points de vue de l’expérience et d’un point de vue systémique en troisième personne.
Title: The collective design of a new object of activity and the development of activity in the context of formative interventions in France and Brazil
Abstract: This article presents two formative interventions using the change laboratory methodology in France and Brazil, in a university teacher training institute and a hospital respectively. Based on cultural-historical activity theory and the theory of expansive learning, the interventions aim to enable participants to discover new meaning by reconceptualizing the object of their activity. In this reconceptualization process, the identification of historically inherited contradictions within activity systems plays a key role. The two interventions present the process as a reorientation of the historical trajectory of the object of activity, requiring the linking of experiential points of view and a third-person systemic point of view.
• Résumés de thèse
Arabaci-Colak (Feryal).— Représentations et positionnements des professionnels de la protection de l’enfance en danger : effets de leur discours sur le devenir des enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance, Bulletin de psychologie, Tome 78 (2), N°588, 2025, p. 105-108.
Title: Representations and positioning of professionals involved in the protection of children at risk: Effects of their discourse on the future of children entrusted to the Child Welfare Service
Carrel (Thomas).— Le modèle de la projection de genre : un modèle explicatif du plafond de verre, de l’effet de backlash et de la falaise de verre, Bulletin de psychologie, Tome 78 (2), N°588, 2025, p. 109-112.
Title: The Gender Projection Model: An explanatory model of glass ceiling, backlash effect and glass clif
• à travers les livres